Nicolas Choquet
dit Champagne
Notes biographiques suppl�mentaires
Il a eu deux Choquette qui sont venus en Nouvelle-France, mais il n'y a qu'un seul anc�tre � toutes les familles CHOQUET-CHOQUETTE.
Antoine CHOQUET, fils d'Antoine et Claude CAILLET, de St-Eustache, ville et archev�ch� de Paris, �pousa Anne TROTTAIN le 29 janvier 1691 � Batiscan. Ils eurent trois enfants, Joseph-�tienne, Marie et Antoine, mais les deux gar�ons moururent en bas �ge, et cette lign�e s'arr�te donc ici. [S5]
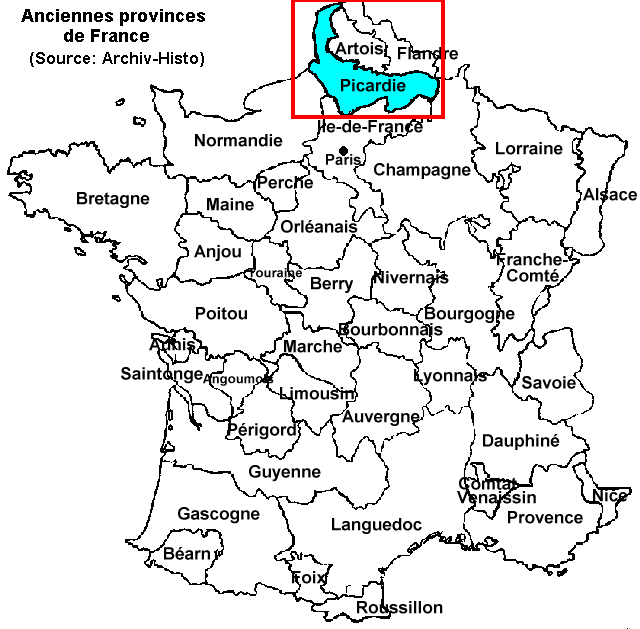 Quant
au seul anc�tre des CHOQUET-CHOQUETTE, il s'appelait NICOLAS, fils
de Nicolas
CHOQUET et de Claudine GREUET. (Voir
les pr�cisions sur le
nom GREUET). Il fut baptis� le
14 f�vrier 1644 [S10], � l'�glise
de St-Firmin de la porte, � Amiens, en Picardie, France.
Cette ville fait aujourd'hui partie du d�partement de la Somme.
Quant
au seul anc�tre des CHOQUET-CHOQUETTE, il s'appelait NICOLAS, fils
de Nicolas
CHOQUET et de Claudine GREUET. (Voir
les pr�cisions sur le
nom GREUET). Il fut baptis� le
14 f�vrier 1644 [S10], � l'�glise
de St-Firmin de la porte, � Amiens, en Picardie, France.
Cette ville fait aujourd'hui partie du d�partement de la Somme.
Les archives d�partementales d'Amiens nous r�v�lent que Nicolas avait 4 fr�res, Jean, Firmin, Jacques et George, et une soeur, �lisabeth. Malheureusement, l'acte de mariage de ses parents, Nicolas et Claudine GREUET, demeure introuvable (on croit que les documents ont �t� perdus dans un incendie). Il semble que les grands-parents de notre anc�tre seraient Nicolas CHOQUET et Jeanne CHASTEL, et qu'ils se seraient mari�s vers 1614 � Amiens. Nous tentons toujours de confirmer cette information, qui appara�t, semble-t-il, dans l'International Genealogical Index des Mormons.
Son arriv�e en Nouvelle-France
Nicolas Choquet faisait partie du c�l�bre r�giment de Carignan. � Le r�giment est envoy� en Nouvelle-France en 1665 pour y combattre les Iroquois qui harc�lent les �tablissements fran�ais.�.1 Nicolas d�barque au pays (� Qu�bec) le 18 ao�t 1665 � bord du navire L�Aigle d�or comme soldat de la compagnie Sali�re. Il est confirm� � Qu�bec quelques jours plus tard, le 24 ao�t.
L�origine de son surnom dit � Champagne � n�est pas claire. Michel Langlois, dans son Dictionnaire biographique des anc�tres qu�b�cois (1608-1700)2 indique : � On l'identifie avec le nomm� Champagne qui faisait partie de cette compagnie. � Nos notes personnelles, tir�es des recherches de monsieur Gaston Choquette, indiquent plut�t que son surnom de CHAMPAGNE lui vient du traditionnel bapt�me du r�giment de Carignan.
Selon les listes du Fort Chambly, Nicolas s�journa quelque temps dans cet �tablissement, maintenant lieu historique national.
Son mariage avec Anne Julien, et son �tablissement � Varennes
Nicolas s'est mari�, � l'�glise Notre-Dame de Montr�al, le 12 novembre 1668 [S10], � Anne Jullien, fille de Pierre Julien et de Marie de Pien, de Saint-Germain-l'Auxerrois � Paris, une Fille du Roy. Le certificat de leur mariage existe encore dans les vo�tes de l'�glise Notre-Dame de Montr�al. Un premier enfant, Julien, nait � Qu�bec le 14 septembre 1669.
Lorsque la paix fut revenue au pays, Nicolas a eu le choix, avec son capitaine (d�apr�s nos recoupements historiques, il s�agirait de Michel-Sidrac du Gu�), de retourner en France avec son r�giment ou de rester au pays. Ceux qui avaient d�cid� de rester au pays avaient �t� gratifi�s d'une concession de terre pr�s de leur capitaine.
En 1972, Sidrac Du Gu� obtint une concession de terre sur l'Ile Sainte-Th�r�se, o� Nicolas s'est donc �tabli comme fermier. L'Ile Sainte-Th�r�se est situ�e dans le milieu du fleuve Saint-Laurent, � 10 milles en aval de Montr�al, directement en face de Varennes.
Plusieurs transactions notari�es nous indiquent qu�entre 1672 et 1687, notre anc�tre partagea son temps entre la Seigneurie de l�Ile Ste-Th�r�se et � une terre de sept arpents de front au Cap-de-la-Trinit� [� Varennes] avec une boulangerie pour servir de logement �. En 1701, il alla s��tablir sur une terre de cent soixante arpents dans la seigneurie de Sainte-Marguerite entre celle du Cap-de-la-Trinit� et celle de Verch�res. � 3
Notes
Nicolas et Anne eurent les enfants suivants, tous n�s � l'Ile Ste-Th�r�se, sauf Julien, n� � Qu�bec (un * indique que l�enfant est mort en bas �ge) :
Nicolas v�cut jusqu'� l'�ge de 78 ans et 11 jours (son acte de d�c�s dit qu'il avait 74 ans). Il mourut le 25 f�vrier 1722 � Varennes et fut inhum� le m�me jour dans le cimeti�re de la paroisse Ste-Anne-de-Varennes. A noter que sur l'acte de s�pulture, il est simplement identifi� comme �tant � le bonhomme Choquette �.
Les descendants de Nicolas se sont �tablis en premier lieu � Varennes, pr�s de Montr�al, pour, par la suite, se propager dans les r�gions de Verch�res, Saint-Denis sur le Richelieu, Beloeil, St-Mathias, Marieville, Richelieu, St-Hyacinthe, dans la r�gion d'Iberville, de Laprairie, etc., et, depuis 300 ans, on les trouve partout, tant aux Etats-Unis, dans les �tats de l'est que dans l'ouest, ainsi que dans les autres r�gions du Canada � l'est et � l'ouest.
Les premiers colons �crivaient leur nom Choquet, mais, par la suite, il a �t� �crit Choquette ou Choquet tel que les noms Paquet-Paquette, etc.
Dans le village de Varennes a �t� �rig� un monument � la gloire du pionnier NICOLAS CHOQUET lors du 300e anniversaire de son arriv�e au pays et dans la r�gion. Ce monument est situ� au coin des rues Nicolas-Choquet et Ren�-Gauthier.
Le 24 ao�t 1664, a �t� confirm� � Notre-Dame de Qu�bec, Nicolas Chouquet, 20 ans. Il est possible que ce soit une d�formation de Choquet, puisque cela correspondrait � l'�ge que Nicolas I avait � ce moment-l�. Cependant, le tout reste � v�rifier puisqu'il est g�n�ralement acquis que Nicolas est d�barqu� � Qu�bec en 1665.
Nicolas habitait la paroisse Ste-Anne de Varennes. Il avait 38 ans, et figurait � titre d'habitant. Sa femme Anne Jullien avait 30 ans. Ils avaient 4 enfants:
Plusieurs personnes sont �videmment curieuses de conna�tre l�origine du nom �Choquet�. Il y a presqu�autant de r�ponses qu�il y a d�historiens ! En voici une, selon les notes de Gaston Choquette (1900-1977) : De Choques, commune du Pas de Calais, arrondissement de Bethune (France). Choquet est un pot en �tain. L'anglais Coket signifiait vase servant de mesure et le bas latin coketa donnait le m�me sens. Moisy, au mot choquet, dit � vase en terre cuite servant � boire �. Choquet et choque (vase plus grand) doivent leur origine � l'habitude qu'ont les Normands, en r�union, de ne jamais vider leurs verres sans les choquer l'un contre l'autre, autrement dit, sans trinquer.
(Dans Origines des familles
Canadiennes-fran�aises par
N.E. Dionne, � la Biblioth�que municipale de Montr�al).
Autre d�finition, qui nous a �t� envoy�e par Bernard Choquet, de Leers, en France (� la fronti�re belge) : � Les vikings, apr�s avoir pay� l'imp�t, � choquet � [choquaient] leurs cornes de boisson comme accord de paiement. �